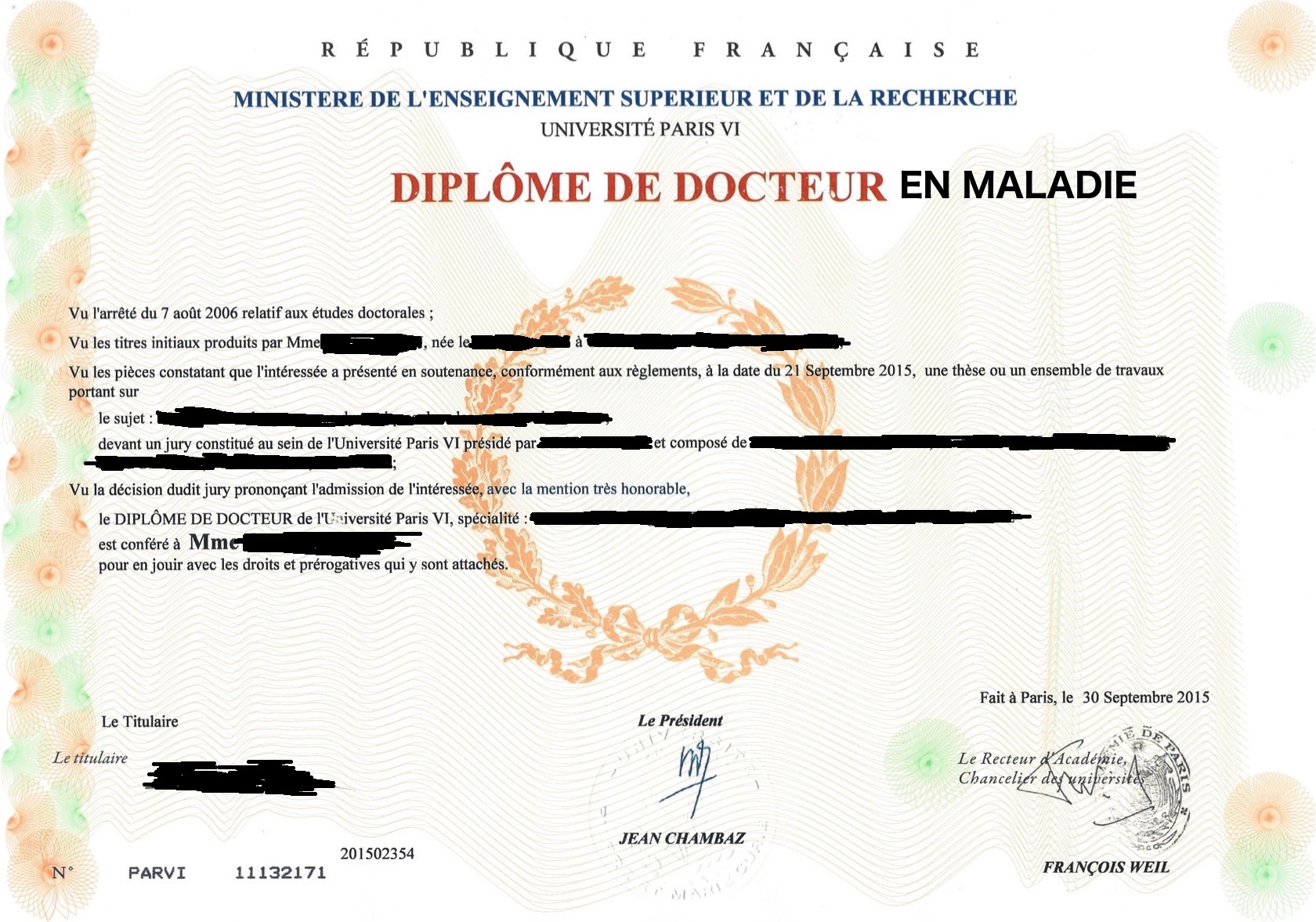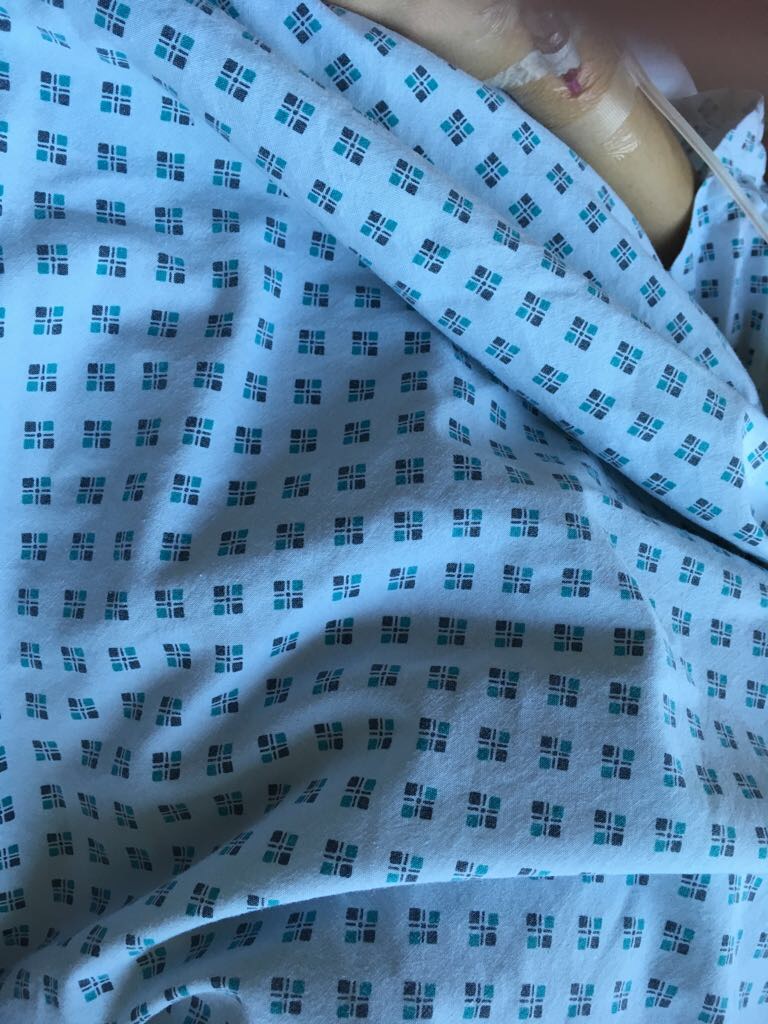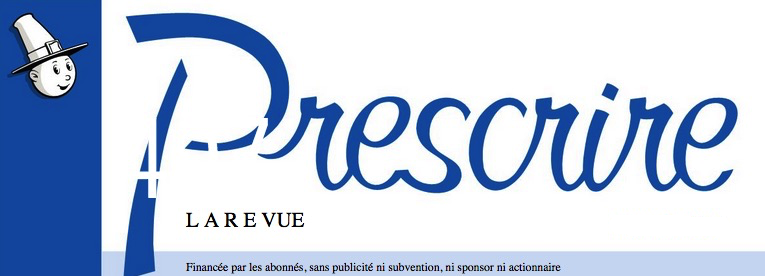Bon. J’ai eu plein de questions à propos du post « La bonne baise ». Plein de gens qui m’ont dit « oh mais c’est hot », ou « oh mais t’es chaude », ou plus intelligent « ça montre bien que le patient n’est pas qu’un numéro, mais un être sexué ». Alors…non. Ou bien oui, mais pas que.
J’avais essayé de dissimuler mon message au moyen de l’image de la relation sexuelle consentie de type « one shot » avec un autre qui ne vous rappelle jamais. Mais le message est mal passé. Et un message qui passe mal, c’est un message mal énoncé. « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ». J’aime cette petite maxime de Nicolas Boileau. C’était au 18ème siècle dans son Art Poétique, et c’est toujours vrai maintenant. Et en effet, tout le monde n’a pas vécu « la bonne baise », et c’est tant mieux. Donc pour des références, je vous suggère le basique « Sex in the city ». Quelques épisodes suffiront, voire même le résumé Wikipedia. C’était donc une métaphore le sexe, un piège, et c’est vrai que c’était facile de tomber dedans. En fait, une partie de moi n’a pas voulu prendre de risque.
Mais finalement, une fois n’est pas coutume, je vais vous faire la petite explication de texte. Et prendre des risques. Après tout, on ne lit pas Kant sans le Profil (de chez Hatier) à côté non ? Sinon on ne s’en sort pas. Hum moui, moui, je m’auto-flatte, je me prends pour Kant, peut-être même pour Dieu.
Voilà de quoi parlait mon article. Du syndrome de Dieu. Un syndrome c’est par définition, un ensemble de symptômes. C’est donc une pathologie que j’ai mise en évidence chez le professionnel de santé, notamment le médecin, en général expérimenté, et allez savoir pourquoi, chez l’homme, et non la femme. J’ai identifié jusqu’à maintenant 3 cas, et comme en médecine, parfois on ne fait un article que pour 1 cas, je me dis que 3, c’est une statistique suffisante pour publier une maladie désormais établie : le syndrome de Dieu. Qu’on appellera probablement un jour, le syndrome de Manon, puisque souvent on donne leurs noms aux maladies à ceux qui les ont mises en évidence, n’est-ce-pas. Hum moui, moui.
Je vous explique dans quelles circonstances vous pouvez rencontrer un médecin atteint de ce syndrome. Vous avez une maladie. Un peu n’importe laquelle. Un truc un peu chronique, plus grave qu’un rhume, moins grave qu’un cancer. Un truc un peu chiant, sur lequel les connaissances avancent un peu, sur lequel la Big Pharma se fait des sous-sous, sur lequel les médecins fougueux tentent disons une petite dizaine de molécules, dans un ordre plus ou moins défini, selon ce qui s’est dit dans les derniers congrès nationaux, européens, mondiaux, hum, moui, moui, mondiaux. Ah, excusez-moi, j’ai encore un petit four coincé dans la gorge.
Donc vous avez une maladie, et vous avez votre première consultation avec le Grand Professeur, recommandé par tout le gratin parisien, national, européen, mondial, hum, moui, moui. C’est ça « la bonne baise ». C’est la consultation. Vous êtes content de cette consultation parce que le Grand Professeur vous explique qu’il va vous sauver, qu’il ne faut plus s’inquiéter maintenant, qu’on va se voir tous les trois mois, et qu’on finira par trouver la bonne des 10 molécules de la Big Pharma au congrès, qui vous remettra sur pied. Vous sortez refait de la consultation.
Mais tout se gâte après. D’où vous êtes « la bonne poire du bon coup », je vous renvoie au texte originel. Le syndrome de Dieu vous l’avez compris, ça consiste à se prendre pour Dieu, une fois, pas deux. A dire des choses, à ne pas les faire. Parce qu’en fait votre maladie est compliquée, les patients ne vont jamais bien, même les 10 molécules parfois ne marchent pas. Alors Dieu est fatigué, et ne veut plus s’intéresser aux patients qu’il ne peut pas ressusciter. Dès la deuxième ou la troisième consultation, tout vexé comme un pou que sa baguette magique n’ait pas marché, le syndromé vous dit : « Bon ben de toute façon, je ne peux rien faire, y a rien qui marchera ». Et bim. Vous comprenez maintenant ou pas ? La bonne poire ? Le sentiment de s’être bien fait avoir ? D’avoir cru rencontrer Dieu et se rendre compte qu’en fait non, pas encore ?
Donc vous vous sentez usurpé. « Baisé » quoi. C’est comme ça qu’on m’a appris à l’école à verbaliser ce sentiment moi.
Du coup, dans « La bonne baise », je n’ai pas dit comment ça se terminait. Parce que dans la vraie vie, vous ne retournez pas en principe voir quelqu’un qui vous a profondément déçu. Mais dans la vraie vie du malade, vous espérez toujours un peu guérir, alors vous vous acharnez, et vous retournez en consultation avec Dieu. Et Dieu vraiment fatigué, finit par statuer, magnanime : « Voyez bien le psychiatre ».
Eh oui, le psychiatre.
Parce que quand Dieu se lasse, et que vous avez envie de vous envoyer vous-même au paradis, avant, il y a quand même un petit passage, par la psychiatrie.